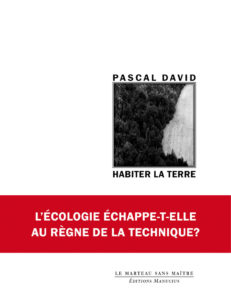Dans Habiter la terre. L’écologie peut-elle échapper au règne de la technique ?, Pascal David, agrégé de philosophie et professeur émérite à l’Université de Bretagne occidentale, propose une réflexion philosophique audacieuse et accessible sur l’écologie, envisagée non pas comme une simple discipline scientifique ou un mouvement militant, mais comme un questionnement profond sur notre rapport au monde. À travers une mise en perspective historique et conceptuelle, l’auteur interroge la capacité de l’écologie à se libérer de la vision technique qui domine la modernité, tout en offrant une méditation sur ce que signifie véritablement habiter la terre.
Une question centrale : l’écologie face à la technique
L’ouvrage s’ouvre sur une question rarement posée : l’écologie peut-elle échapper au règne de la technique moderne, cette vision mécaniste du monde qui s’impose dès le XVIIe siècle avec des figures comme Galilée, Descartes et Huygens ? David souligne que l’écologie, bien que portée par l’urgence de sauvegarder la planète, risque de rester prisonnière d’une conception technique qu’elle prétend pourtant combattre. Cette vision, héritée de la révolution scientifique, réduit la nature à un ensemble de ressources exploitables, un simple environnement au service de l’homme. L’auteur s’interroge : l’écologie, en s’appuyant sur des fondements scientifiques issus du darwinisme, ne reconduit-elle pas, à son insu, cette même logique technicienne qu’elle critique ?
Pour répondre, David convoque des penseurs majeurs, notamment José Ortega y Gasset, Karl Marx et Martin Heidegger, tout en s’appuyant sur des références littéraires et poétiques, de La Fontaine à Hölderlin. Loin de proposer une critique négative de l’écologie, il cherche à la renforcer en l’éclairant sous un angle philosophique, en questionnant ses présupposés pour mieux en révéler les limites et les potentialités.
La technique moderne : une rupture historique
Pascal David commence par retracer l’émergence de la technique moderne, qu’il distingue des savoir-faire traditionnels. S’appuyant sur Ortega y Gasset, il rappelle que l’homme a toujours été lié à la technique, mais que celle-ci prend une forme radicalement nouvelle à partir du XVIIe siècle. Avec Galilée, qui s’inspire des arsenaux de Venise, et Descartes, fasciné par les dissections dans la Kalverstraat d’Amsterdam, la science moderne naît hors des universités, dans une « école buissonnière » faite d’observations et de rêveries. Cette science mathématique de la nature, qui voit le monde comme un ensemble de mécanismes, marque une rupture avec la tekhnè grecque, un art de dévoilement qui faisait apparaître la réalité dans sa dimension poétique et sacrée.
Heidegger approfondit cette distinction. La technique moderne, selon lui, n’est plus un mode de dévoilement, mais une entreprise d’exploitation et de domination. Elle transforme la nature en un stock de ressources, comme l’illustre l’usine marémotrice sur le Rhin, qui mure le fleuve pour en extraire l’énergie, contrairement au moulin à vent qui s’insère dans son mouvement naturel. David montre que cette vision technicienne, en objectivant la nature, la réduit à un simple environnement, un concept anthropocentrique qui place l’homme au centre de tout.
L’écologie : science, militantisme et politique
L’auteur définit l’écologie à trois niveaux : intellectuel, militant et politique. Sur le plan intellectuel, elle est une science née au XIXe siècle avec Ernst Haeckel, disciple de Darwin, qui forge le terme Ökologie (du grec oikos, maison, et logos, discours). Cette science étudie les milieux où vivent les êtres vivants, mais repose sur des présupposés scientistes hérités de Darwin, souvent dogmatiques.
Sur le plan militant, l’écologie est une lutte contre la dévastation de la planète, face à l’exploitation effrénée des ressources et à la logique du toujours plus. Politiquement, l’écologie, née dans les marges post-1968, est devenue un courant transpartisan, porté par des notions comme le développement durable ou la sauvegarde de l’environnement. Mais ces éléments de langage, bien qu’indispensables, restent prisonniers d’une vision utilitariste de la nature, envisagée comme un simple cadre de vie pour l’homme.
Marx : la nature comme corps de l’homme
Pour dépasser ces limites, David se tourne vers Marx, qui offre une vision de la nature bien plus riche que celle de l’écologie contemporaine. Dans les Manuscrits de 1844, Marx décrit la nature comme le corps non-organique de l’homme, un élément indissociable de son être. Loin de se limiter à un environnement, la nature est à la fois le milieu où l’homme s’inscrit et un vis-à-vis qu’il transforme par le travail. Ce dernier, activité consciente et négative, distingue l’homme de l’animal et lui permet de s’humaniser. David, s’appuyant sur Simone Weil, rejette l’idée d’un Marx matérialiste grossier : il voit en lui un penseur idéaliste, héritier de Hegel, pour qui la nature est un antagoniste à transformer, mais non à détruire. Cette perspective invite les écologistes à repenser leur rapport à la nature, au-delà de la simple préservation d’un milieu.
Heidegger : habiter poétiquement la terre
Heidegger occupe une place centrale dans l’ouvrage. Dès les années 1930, il s’inquiète de l’impact de la technique, qui pille et asphyxie la planète par sa logique de faisance universelle. Dans un monde où tout devient faisable – y compris l’homme lui-même via les manipulations génétiques –, l’être humain s’éloigne de son essence, de son rapport à l’être. David souligne que Heidegger n’est pas un écologiste au sens classique : il ne réduit pas la nature à un espace vert ni l’homme à un simple occupant d’un milieu. Pour Heidegger, habiter ne se résume pas à occuper un logement ou à gérer une planète comme un concessionnaire. Habiter, c’est être en relation poétique avec la terre, comme le dit Hölderlin : C’est poétiquement que l’homme habite sur cette terre.
La maison, au sens de l’oikos, est plus qu’un abri ou une machine à habiter (Le Corbusier). Elle est un foyer, un lieu de vie et de partage, où convergent le dedans et le dehors, la terre et le ciel, les mortels et les divins. David illustre cette idée avec des références poétiques, comme la maison de lumière d’Eschyle. Heidegger propose une sérénité (Gelassenheit), un rapport libre à la technique, qui dit oui à son usage inévitable tout en lui disant non pour préserver l’intimité de l’être humain. Cette équanimité, loin d’être une résignation, invite à repenser notre présence au monde.
Une invitation à repenser l’écologie
À la croisée de la philosophie, de la poésie et de l’histoire des idées, cet essai est une invitation à repenser notre lien à la nature et à nous-mêmes. Accessible, mais profond, il captive par sa capacité à relier des penseurs comme Marx et Heidegger à des enjeux contemporains. En posant des questions essentielles – qu’est-ce qu’habiter ? qu’est-ce que la nature ? –, Pascal David offre un ouvrage stimulant qui donne à comprendre comment l’écologie peut devenir une véritable pensée de l’habitation.
Habiter la terre – Collection Le Marteau sans Maître – Editions Manucius