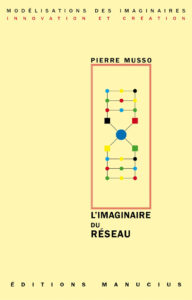Dans un monde où le terme « réseau » évoque instantanément Internet, les médias sociaux ou les infrastructures urbaines, l’essai de Pierre Musso, L’Imaginaire du réseau, publié aux éditions Manucius dans la collection « Modélisations des Imaginaires », offre une plongée passionnante dans les racines profondes de cette notion devenue omniprésente. Pierre Musso, philosophe et spécialiste des communications, déconstruit le réseau non comme une simple invention technique, mais comme une figure mythique et symbolique qui a évolué au fil des siècles. Son ouvrage retrace une généalogie qui relie le filet antique au cyberespace contemporain, en passant par les révolutions industrielles. Accessible aux non-spécialistes, ce texte invite à réfléchir comment le réseau réenchante notre quotidien tout en structurant notre compréhension du monde.
Des origines mythiques au techno-imaginaire
Le réseau tire son étymologie du latin retis, signifiant filet, un outil artisanal pour capturer ou tisser. Pierre Musso commence par explorer cet imaginaire originel, ancré dans les techniques du tissage et de la chasse. Dès l’Antiquité, le filet symbolise une ambivalence : il retient tout en laissant passer, enveloppe sans étouffer. Dans la mythologie grecque, des figures féminines comme les Moires – déesses fileuses qui tissent le destin – ou Arachné, transformée en araignée par Athéna, incarnent cette association entre tissage, temps et ruse. La mètis, cette intelligence astucieuse décrite par Marcel Détienne et Jean-Pierre Vernant, lie le réseau au piège, au passage entre contraires.
La médecine antique renforce ce lien avec le corps. Hippocrate et surtout Galien, au IIe siècle, décrivent le cerveau comme un rete mirabile – un réseau merveilleux – un lacis de vaisseaux plus fin que tout filet humain. Cette métaphore organique perdure : le réseau est sur le corps (comme un vêtement), puis dans le corps, expliquant son fonctionnement. L’auteur souligne comment cette dualité – technique et corporelle – forge un techno-imaginaire, selon l’expression de Georges Balandier, oscillant entre messianisme (progrès) et catastrophisme (surveillance).
La formalisation aux Siècles des Lumières
Au XVIIe siècle, Descartes et Leibniz marquent une rupture en formalisant le réseau. Descartes compare le corps à une machine hydraulique, avec un réseuil pour le cerveau, intégrant la découverte de la circulation sanguine par William Harvey. Leibniz, philosophe-ingénieur, mathématise le réseau via l’Ars combinatoria, distinguant des structures économes (harmonie préétablie) ou denses (influence réciproque). Ces idées préfigurent les réseaux centralisés, comme les chemins de fer en étoile autour de Paris. Le XVIIIe siècle, avec l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, amplifie cette rationalisation. Les ingénieurs, formés dans des écoles comme Polytechnique, posent des réseaux sur le territoire : fortifications, canaux, cartes topographiques. La nature elle-même est mise en réseaux – Malpighi observe des microstructures réticulées dans les végétaux, tandis que la cristallographie naissante définit des mailles géométriques. Diderot, dans Le Rêve de d’Alembert, étend cette identification corps-réseau au politique : centralisé, il évoque le despotisme ; décentralisé, l’anarchie. Cette vision biopolitique – surveillance versus circulation – annonce les débats modernes sur Internet.
Le mythe moderne et la rétiologie contemporaine
Le XIXe siècle consacre le réseau comme concept et mythe. Henri Saint-Simon l’utilise pour théoriser la transition vers une société industrielle fluide, où les réseaux (chemins de fer, télégraphe) fluidifient les flux sociaux. Ses disciples saint-simoniens, comme Michel Chevalier, fétichisent ces infrastructures comme symboles d’« association universelle », promouvant paix, égalité et prospérité. Proudhon et Kropotkine y voient un choix politique : réseau en étoile (centralisé) versus en échiquier (décentralisé).
À cette longue généalogie du réseau succède un nouveau paradigme technologique qui domine l’imaginaire contemporain. Celui du réseau, érigé en divinité séculière, dont l’Internet est une des lumineuses apparitions. Musso critique la rétiologie – fusion de retis et logos – une idéologie dégradée où le réseau devient un passe-partout explicatif. Manuel Castells parle de société en réseaux, tandis que la cyberculture (Matrix) imagine un cyberspace hybride homme-machine. Partout cette figure s’impose. Tout est réseau, voire « réseau de réseaux » : la planète, la ville, le territoire, les institutions, l’entreprise, l’État… et les individus branchés. Obligation est faite à chacun de se connecter aux réseaux et de se déplacer dans des réseaux. Le réseau-technique promet le fonctionnement « efficace » du monde hyper-industriel et le réseau-technologie permet d’en rendre compte et de lui donner un sens. Le réseau est un repère, comme jadis le fut l’arbre : il s’opposerait à la pyramide et à la hiérarchie. Et pourtant son imaginaire est ambivalent : tantôt il offre communication et fluidité et tantôt surveillance et contrôle.
Conclusion : du filet à l’enlacement global
Avec L’Imaginaire du réseau, Pierre Musso propose une généalogie passionnante reliant le tissage antique au cyberespace contemporain. De Galien à Deleuze, via les utopies saint-simoniennes et les dystopies de Matrix, il dévoile comment le réseau – polysème technique et symbolique – enveloppe corps, territoires et sociétés. Remplaçant l’arbre vertical par un mouvement horizontal vers l’avenir, il pose la question lancinante : libérateur ou piège subtil ? Sérieux et fluide, riche en références vivantes, cet essai essentiel invite à plonger dans ses mailles pour décrypter notre ère connectée et réenchanter le quotidien.